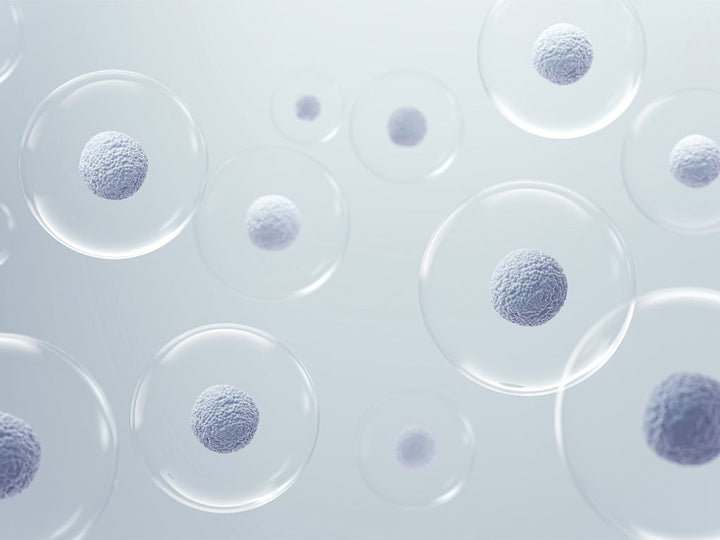
Fertilité
Stimuler sa fertilité en prenant soin de son alimentation et de sa santé
La fertilité désigne la capacité biologique à concevoir naturellement, sans recours à l’assistance médicale. De multiples facteurs l’influencent, certains étant liés à des aspects génétiques ou médicaux difficilement modifiables, tandis que d’autres relèvent de comportements ou de choix de vie sur lesquels il est possible d’agir. Dans un contexte où l’infertilité touche désormais un couple sur quatre, soit environ 3,3 millions de personnes en France, adopter une hygiène de vie favorable à la santé reproductive représente un levier important pour optimiser ses chances de conception.
Sommaire
1. Fertilité, pourquoi et comment veiller à une alimentation saine et équilibrée ?
Les études sur la relation entre l'alimentation et la fertilité humaine se sont multipliées au cours des dernières décennies. Les résultats de ces recherches ont permis d'identifier clairement qu’une alimentation équilibrée et saine en période de préconception améliore la fertilité autant chez la femme que chez l’homme. Pour fonctionner de manière optimale, l’organisme a besoin de macronutriments dans des proportions précises : les glucides doivent représenter 40 à 55 % de l’apport énergétique total (AET), les protéines 10 à 20 %, et les lipides 35 à 40 %. À partir de ces données scientifiques, plusieurs recommandations clés se dégagent.
A. Mettre l’accent sur les bonnes graisses
Les lipides sont majoritairement représentés par les acides gras, dont la répartition doit respecter un équilibre nécessaire au bon fonctionnement du corps. Ils nous fournissent de l’énergie, contribuent à la synthèse de nos hormones et des membranes des cellules, et permettent l’absorption des vitamines A, D, E et K. Mais l’alimentation actuelle contient en général trop d’acides gras saturés et pas assez d’acides gras monoinsaturés et surtout polyinsaturés (dont les fameux omégas 3). Ces derniers sont notamment essentiels pour la santé cardiovasculaire, cérébrale et luttent contre l’inflammation.
Il est donc important de consommer des oléagineux comme les amandes, les noisettes, les noix, du poisson gras comme le saumon, le thon, le maquereau, les sardines ainsi que des huiles végétales riches en graisses insaturées comme le colza, le lin, le soja.
B. Veiller à une glycémie stable
Des études montrent un lien entre des charges glycémiques trop élevées et des troubles de l’ovulation. Les pics de glycémie entraînent une production d’insuline trop importante. Cette stimulation excessive peut, à terme, conduire à une résistance à l’insuline, un état où les cellules répondent moins efficacement à l’action de cette hormone. L’insuline, à des niveaux élevés, déséquilibre l’axe hormonal, en augmentant la production d’androgènes (hormones mâles) par les ovaires. Ce déséquilibre peut perturber l’ovulation, voire provoquer une anovulation (absence d’ovulation).
Ce phénomène est bien documenté, notamment chez les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), un trouble fréquent de l’ovulation lié à une résistance à l’insuline dans 50 à 70 % des cas. À l’inverse, des niveaux d’insuline mieux contrôlés (par une alimentation à index glycémique bas et une activité physique régulière) peuvent favoriser une meilleure sensibilité à l’insuline, rééquilibrer les hormones sexuelles, améliorer la régularité des cycles menstruels et l’ovulation.
Pour limiter les pics glycémiques, il est conseillé de privilégier les aliments à index glycémique bas : féculents, céréales et farines complètes, légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots rouges), fruits (pommes, poires, baies), légumes et oléagineux (les noix de Grenoble ou du Brésil, les graines de lin, de chia). À l’inverse, les confiseries et produits à base de sucre blanc raffiné sont à limiter autant que possible. Mieux vaut opter pour des alternatives comme le sucre stévia, dont l’impact sur la glycémie est plus modéré.
C. Faire le plein de protéines
Les protéines jouent un rôle clé dans la fertilité, car ce sont les briques essentielles à la formation des cellules et des hormones reproductives (œstrogènes, progestérone, testostérone…). Il est important de privilégier les protéines de sources végétales, moins riches en acides gras saturés que les protéines animales, et riches en fibres, antioxydants, vitamines et minéraux. Néanmoins, une consommation modérée de protéines animales reste bénéfique, notamment pour l’apport en vitamine B12 et en fer héminique, une forme mieux absorbée que le fer d’origine végétale. Poissons et viandes rouges peuvent ainsi être consommés environ deux fois par semaine.
2. Quels rôles jouent les micronutriments sur la fertilité ?
La complémentation en micronutriments spécifiques a démontré son efficacité dans le domaine de la fertilité. Certains jouent un rôle essentiel aussi bien chez la femme que chez l’homme.
A. Acide folique
C’est la plus connue des supplémentations recommandées chez la femme en période de préconception et de grossesse. L’acide folique (ou vitamine B9) est l’une des vitamines B essentielles à la bonne croissance du bébé à naître. De nombreuses études ont montré que l’acide folique contribue à réduire le risque de malformation cérébrale (anomalies de fermeture du tube neural) lors de la grossesse. De même, la prise d'acide folique est associée à une fréquence plus faible d'infertilité.
Cependant, les sources alimentaires ne suffisent pas à assurer l’apport en folate requis pour protéger contre ces malformations. En effet, 75 % des femmes en âge de procréer présentent des apports en folates inférieurs aux recommandations nutritionnelles. En cas de désir de grossesse, il est donc recommandé de prendre le supplément au moins trois mois avant de tomber enceinte.
Découvrez nos conseils sur la supplémentation en acide folique
B. Myo-inositol
Le myo-inositol est une molécule naturellement présente dans les membranes cellulaires. Une fois libéré à l’intérieur de la cellule, il agit comme messager secondaire :
- en imitant l’action de l’insuline, notamment en activant les transporteurs du glucose
- en favorisant l’action de la FSH, hormone de stimulation folliculaire.
Ce mécanisme en fait un acteur clé de la physiologie reproductive, avec des effets positifs sur le développement des ovocytes. Dans le liquide folliculaire, le myo-inositol est reconnu comme un marqueur de bonne qualité ovocytaire, favorisant la maturation des follicules et le développement embryonnaire. En procréation médicalement assistée (PMA), il améliore la sensibilité ovarienne ainsi que la maturation ovocytaire. Par ailleurs, son association à l’acide folique en période préconceptionnelle a montré une réduction du risque d’anomalies de fermeture du tube neural. Ses effets bénéfiques sont démontrés à 4 g par jour.
C. L'iode, le sélénium et le zinc : 3 oligoéléments essentiels pour la fertilité
L’iode est indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes, qui régulent la croissance et la maturation cellulaires. Son rôle dans le développement cérébral du fœtus, particulièrement durant les premiers mois de grossesse, est crucial. Pourtant, 75 % des femmes en âge de procréer présentent des apports insuffisants. Une carence en iode peut provoquer une hypothyroïdie légère, affectant la fertilité, retardant l’âge du premier enfant et augmentant le risque de fausses couches et d’infertilité inexpliquée.
Le sélénium intervient dans le développement des follicules ovariens responsables de la production des ovocytes. Il agit également comme antioxydant, protège contre les métaux lourds et participe au bon fonctionnement de la thyroïde. Présent en concentration optimale dans les ovaires, il favorise un environnement cellulaire propice au développement folliculaire et à la qualité des ovocytes. Chez l’homme, il soutient la production et la motilité des spermatozoïdes, expliquant sa forte présence dans les testicules.
Enfin, le zinc, impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques, contribue à la synthèse protéique et à la régulation hormonale. Des études récentes confirment son rôle dans la santé reproductive. Il participe à la maturation des ovocytes ainsi qu’au bon déroulement de la fécondation chez la femme et améliore la qualité des spermatozoïdes chez l’homme.
D. Les autres vitamines du groupe B, les vitamines C, D et E
La vitamine D3 contribue à la production des hormones sexuelles et participe à la régulation de la croissance cellulaire. Elle soutient également la synthèse de l’insuline et facilite l’entrée du glucose dans les cellules. Les vitamines C et E jouent un rôle d’antioxydants et participent à la régénération d'autres antioxydants comme le glutathion. Les vitamines du groupe B, quant à elles, jouent un rôle indispensable en tant que cofacteurs dans de nombreuses réactions métaboliques de l’organisme, notamment dans les cycles des folates et de la méthylation, et peuvent contribuer au soutien des défenses antioxydantes.
3. Quelles habitudes de vie doit-on modifier pour favoriser la fertilité ?
Le mode de vie du couple, tant chez l’homme que chez la femme, exerce également une influence significative sur la fertilité.
A. Tabac
La consommation de tabac de l’un des partenaires réduit la fertilité. La cigarette est même considérée comme l’ennemi numéro 1 de la fertilité. Chez la femme, le tabagisme est relié à une diminution des réserves ovariennes, à un retard de conception ainsi qu’à un risque plus élevé de fausses couches. Chez l’homme, il réduit considérablement la qualité du sperme. Au vu de ces éléments, arrêter de fumer ou, à défaut, diminuer sa consommation devient primordial. Dans ce cadre, il ne faut pas hésiter à se faire aider et accompagner. À noter que le tabagisme passif est aussi nocif.
B. Surpoids et dénutrition
L’obésité, comme la dénutrition, sont associées à une augmentation des troubles de l’ovulation. L’obésité entraîne un risque d’anovulation (absence d'ovulation), ce qui compromet les tentatives de conception. Il a été montré qu'une perte de 5% du poids peut permettre la normalisation de certains facteurs dont l’effet conduit à rétablir la maturation normale des ovocytes et éviter dans certains cas le recours aux procédures d’aide à la procréation.
À l’opposé, un apport alimentaire insuffisant ou de fortes restrictions alimentaires entraînent une perte de poids corporel, un manque global de nutriments et une augmentation de l'infertilité. Il est donc conseillé de se rapprocher d’un IMC (Indice de Masse Corporelle) compris entre 19.5 et 24.9.
C. D’autres paramètres importants
L’aspect psychologique doit également être pris en considération. Le stress créé un environnement moins favorable à la conception. Une activité physique régulière et adaptée offre alors de nombreux bienfaits, tous favorables à l’optimisation des chances de grossesse.
Autre point essentiel, dont on parle rarement : la fréquence des rapports sexuels. Des relations régulières (2 à 3 fois par semaine), au moment opportun du cycle, représentent une condition importante pour favoriser une conception. Cependant, il est tout aussi important de préserver la spontanéité et l’équilibre du couple.
Heureusement, il existe plusieurs méthodes simples pour repérer la période d’ovulation : utiliser des tests d’ovulation disponibles en pharmacie, analyser sa température chaque matin, observer les modifications des pertes vaginales, ou encore calculer son cycle menstruel.
Cet article est uniquement informatif et ne remplace pas une consultation ou les conseils de votre médecin.
Références scientifiques
Santé publique France : recommandations relatives à l’alimentation, à l’activité physique et à la sédentarité pour les adultes, 2019
Organisation Mondiale de la Santé : Rapport de l'OMS sur l’infertilité, 2020
« SOPK et insuline : les liaisons dangereuses » jeudi 14 septembre 2023. Partie 1 SOPK : la faute à l’insuline ? Dr Geoffroy Robin
Chiu YH, Chavarro JE, Souter I. Diet and female fertility: doctor, what should I eat? Fertil Steril. 1 sept 2018;110(4):560‑9.
Safarinejad MR, Hosseini SY, Dadkhah F, Asgari MA. Relationship of omega-3 and omega-6 fatty acids with semen characteristics, and anti-oxidant status of seminal plasma: a comparison between fertile and infertile men. Clin Nutr Edinb Scotl. févr 2010;29(1):100‑5.
Wilson RD, Wilson RD, Audibert F, Brock JA, Carroll J, Cartier L, et al. Pre-conception Folic Acid and Multivitamin Supplementation for the Primary and Secondary Prevention of Neural Tube Defects and Other Folic Acid-Sensitive Congenital Anomalies. J Obstet Gynaecol Can. 1 juin 2015;37(6):534‑49.
Chiu TTY, Rogers MS, Law ELK, Briton-Jones CM, Cheung LP, Haines CJ. Follicular fluid and serum concentrations of myo-inositol in patients undergoing IVF: relationship with oocyte quality. Hum Reprod Oxf Engl. juin 2002;17(6):1591‑6.
Mintziori G, Mousiolis A, Duntas LH, Goulis DG. Evidence for a manifold role of selenium in infertility. Hormones. 1 mars 2020;19(1):55‑9.
Künzle R, Mueller MD, Hänggi W, Birkhäuser MH, Drescher H, Bersinger NA. Semen quality of male smokers and nonsmokers in infertile couples. Fertil Steril. 1 févr 2003;79(2):287‑91.
Silvestris E, Lovero D, Palmirotta R. Nutrition and Female Fertility: An Interdependent Correlation. Front Endocrinol. 2019;10:346.
Anderson K, Nisenblat V, Norman R. Lifestyle factors in people seeking infertility treatment – A review. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2010;50(1):8‑20.
Carlsen E, Giwercman A, Keiding N, Skakkebaek NE. Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years. Br Med J. 12 sept 1992;305(6854):609‑13.
Chiu T.Y. et al, Follicular fluid and serum concentrations of myo-inositol in patients undergoing IVF: relationship with oocyte quality. Human Reproduction Vol.17, No.6 pp. 1591–1596, 2002.
Caprio et al. Myo-inositol therapy for poor-responders during IVF: a prospective controlled observational trial. Journal of Ovarian Research. 2015; 8:37.
Myoinositol: The Bridge (PONTI) to Reach a Healthy Pregnancy. Pietro Cavalli and Elena Ronda. Int J Endocrinol. 2017; 2017: 5846286.