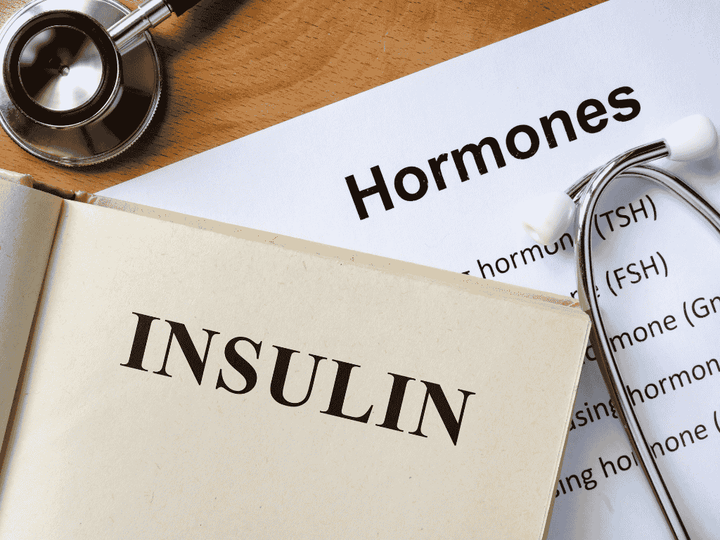
SOPK
Le SOPK, c’est quoi ? Mieux comprendre ce déséquilibre hormonal
Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est le trouble hormonal le plus courant chez les femmes en âge de procréer. En France, il concernerait environ 15 % d'entre elles. Pourtant, malgré sa fréquence, cette pathologie reste largement sous-diagnostiquée : près de la moitié des femmes atteintes ne savent pas qu'elles en sont porteuses, et il faut en moyenne sept ans avant qu’un diagnostic soit posé . Ce retard s’explique par la diversité des symptômes, souvent banalisés ou attribués à d'autres causes. Face à ce constat, il devient essentiel de mieux comprendre ce déséquilibre hormonal, ses manifestations, ses conséquences, et les moyens de le reconnaître plus rapidement.
Sommaire
1. Cycle menstruel et déséquilibre hormonal chez la femme SOPK
Le cycle menstruel repose sur une régulation hormonale précise entre le cerveau et les ovaires. Ce dialogue hormonal coordonne l’ovulation, la fertilité et le bon développement sexuel de la femme.
Sur une durée moyenne de 28 jours, deux grandes phases se succèdent. La première, appelée phase folliculaire (du jour 1 au 14), commence avec la sécrétion de GnRH par le cerveau, qui stimule la production des hormones LH en petite quantité et FSH en plus grande quantité, cette dernière favorisant la croissance des follicules (structures en forme de sac situées dans les ovaires et dans lesquelles se développe l'ovocyte, cellule reproductrice féminine).
Parmi ces follicules, un seul devient dominant : il continue sa maturation tandis que les autres dégénèrent.
En parallèle, la production croissante d’œstrogènes par le follicule dominant entraîne un pic soudain de LH autour du 14e jour du cycle. Ce pic de LH déclenche l’ovulation, c’est-à-dire la libération de l’ovocyte par le follicule mûr.
Ensuite, la phase lutéale (du jour 15 au 28) voit le follicule rompu se transformer en corps jaune, lequel sécrète progestérone et œstrogènes afin de préparer l’utérus à une éventuelle grossesse. En l’absence de fécondation, la chute des hormones entraîne les règles.
L’ensemble du processus repose sur un mécanisme de rétrocontrôle hormonal qui en assure la régularité. Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) perturbe cette régulation.
Le déséquilibre entre LH et FSH, marqué par un excès de LH, empêche la maturation des follicules et bloque l’ovulation.
Ce dérèglement favorise également une production accrue d’hormones androgènes (hormones sexuelles masculines comme la testostérone), normalement présentes en faibles quantités chez la femme.
2. Quels sont les critères de diagnostic du SOPK ?
Le diagnostic du SOPK nécessite la présence d’au moins 2 des 3 critères de Rotterdam suivant :
- l’hyperandrogénie clinique (acné, hirsutisme, alopécie) et/ou biologique ;
- le dysfonctionnement ovulatoire (cycles menstruels irréguliers) ;
- les ovaires polykystiques à l'échographie intravaginale ou le taux élevé d'AMH.
a. Hyperandrogénie biologique ou clinique, quelles différences ?
L’hyperandrogénie clinique correspond aux manifestations résultant d’une production excessive de testostérone.
Elle se manifeste chez environ 70 % des femmes atteintes de SOPK par une hyperpilosité (hirsutisme), ainsi que par de l’acné et une chute de cheveux (alopécie).
L’hyperpilosité désigne une croissance excessive de poils, le plus souvent de duvet, généralement dans des zones déjà pileuses chez la femme. Dans les formes les plus marquées, on retrouve l’hirsutisme, une pilosité dense et épaisse pouvant apparaître sur des zones normalement dépourvues de poils chez la femme, telles que le visage, la poitrine, le dos, les fesses ou la face antérieure des cuisses.
Sur le plan biologique, l’hyperandrogénie est caractérisée par un taux de testostérone libre ≥ 50 ng/dL.
b. Dysfonctionnement ovulatoire et cycles irréguliers
L’hyperandrogénie, en plus de ses effets cutanées et pilaires, influence également la régularité du cycle menstruel en perturbant le fonctionnement ovulatoire, ce qui conduit fréquemment à des troubles du cycle.
Cette rareté ou absence d’ovulation (oligo-anovulation) provoque des cycles menstruels irréguliers, souvent allongés au-delà de 35 à 40 jours (oligoménorrhée).
La spanioménorrhée, elle, correspond à un espacement des cycles supérieur à 6 à 8 semaines, pouvant évoluer vers une interruption totale des règles (aménorrhée).
Ces dysfonctionnements constituent la cause principale d’infertilité chez les femmes en âge de procréer. Environ 75 % des femmes présentant un syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) rencontrent des difficultés de fertilité.
c. Ovaires polykystiques à l’échographie intravaginale ou taux élevé d’AMH
Les ovaires polykystiques se caractérisent par la présence de nombreux petits follicules non développés dans les ovaires. Deux méthodes permettent de les identifier.
L’échographie transvaginale : les follicules, riches en liquide, apparaissent sous forme de structures noires et rondes à l’intérieur des ovaires, eux-mêmes visibles en gris clair à l’image. Le diagnostic repose sur la présence d’au moins 20 follicules par ovaire et/ou un volume ovarien ≥ 10 mL.
Depuis 2023, le dosage sanguin de l'hormone anti-müllérienne (AMH) est reconnu comme outil diagnostique du SOPK. Il existe une forte corrélation entre le nombre de follicules observés à l’échographie et le taux d’AMH. Une valeur > 4,5 ng/mL est très en faveur d’un SOPK. Ce dosage peut compléter ou remplacer l’échographie.
3. Quels sont les symptômes du SOPK ?
Il n’y a pas un seul SOPK mais plusieurs formes de SOPK. Ces symptômes sont très variables d’une femme à l’autre. La maladie peut être discrète ou, au contraire, très invalidante. Ils peuvent affecter de façon significative la qualité de vie et le quotidien.
4. SOPK, quels sont les risques et complications à long terme ?
Les symptômes du SOPK varient au cours de la vie. Chez les femmes jeunes, les signes les plus fréquents sont liés à l’hyperandrogénie et aux troubles de l’ovulation. Avec l’âge, ces manifestations tendent à s’atténuer, tandis que des complications d’ordre métabolique deviennent plus marquées.
À long terme, le SOPK peut avoir des répercussions importantes sur la santé. Il augmente le risque de développer un syndrome métabolique, qui associe surpoids abdominal, anomalies des lipides sanguins, hypertension artérielle et troubles de la régulation du glucose.
Ces facteurs favorisent l’insulinorésistance, pouvant évoluer vers un diabète de type 2, et constitue un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, comme l’infarctus du myocarde ou l’AVC.
De plus, l’excès d’androgènes contribue à une accumulation de masse grasse, elle-même impliquée dans l’apparition de l’insulinorésistance.
Le risque de diabète de type 2 est ainsi multiplié par trois chez les femmes atteintes de SOPK par rapport à celles qui ne le sont pas. Un risque accru de cancer de l’endomètre avant la ménopause a également été identifié, même si ce risque reste faible.
Enfin, les conséquences psychologiques ne doivent pas être sous-estimées. Le SOPK est souvent associé à une souffrance mentale, notamment sous forme d’anxiété et de troubles dépressifs.
5. SOPK, comprendre les causes profondes de ce déséquilibre hormonal
Les déséquilibres hormonaux à l’origine du SOPK sont probablement dus à une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux.
a. SOPK et Influence génétique
Le SOPK présente une forte composante héréditaire. Entre 60 et 70 % des filles dont la mère est atteinte développent à leur tour des symptômes.
À ce jour, aucune mutation unique n’a été identifiée comme « gène du SOPK ». Environ une vingtaine de gènes de prédisposition sont aujourd’hui connus, mais ils ne permettent d’expliquer qu’une minorité des cas, soit moins de 10 %.
De plus, certains facteurs environnementaux, notamment les perturbateurs endocriniens, sont suspectés de contribuer au développement du SOPK, sans preuve établie à ce jour.
b. Impact de l’environnement et du mode de vie sur le SOPK
Le stress oxydant, souvent lié à une inflammation chronique, joue un rôle clé dans le développement du SOPK. Il résulte d’un déséquilibre entre la production de radicaux libres et les mécanismes de défense antioxydants, entraînant des dommages aux cellules, aux lipides, aux protéines et à l’ADN.
L’inflammation de bas grade, ou inflammation chronique de faible intensité, se caractérise par une activation modérée mais persistante du système immunitaire. Contrairement à l’inflammation aiguë, cette réponse s’installe sur la durée, souvent sans symptômes visibles.
Elle est favorisée par :
- une alimentation déséquilibrée,
- le stress chronique,
- la sédentarité,
- le surpoids,
- le tabagisme,
- l’exposition aux polluants
- certaines maladies chroniques.
Cet état inflammatoire en bruit de fond amplifie de nombreux troubles : fatigue, douleurs, prise de poids, diabète, maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, cancer, dépression... D'où l'importance d'une alimentation variée et équilibrée, d'une activité physique régulière et d'une bonne hygiène de vie pour limiter ces facteurs de risque.
Cet article est uniquement informatif et ne remplace pas une consultation ou les conseils de votre médecin.